Dans les discours des managers, des DRH, dans les accords collectifs, institutionnels ou politiques… le concept d’employabilité s’impose. Défini par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) comme «l’aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi, à progresser au travail et à s’adapter au changement tout au long de la vie professionnelle », ce concept paraît à première vue séduisant, voire émancipateur avec des promesses d’autonomie, de mobilité choisie, d’évolution permanente…
Pourtant, l’employabilité telle qu’elle est aujourd’hui promue et mise en œuvre, constitue l’un des pièges les plus redoutables pour le monde du travail. Loin d’être une solution face aux difficultés à trouver un emploi, elle aggrave le problème en opérant un renversement de responsabilités aussi habile que pervers : ce ne sont plus les défaillances systémiques du marché du travail, les choix politiques destructeurs ou les stratégies patronales prédatrices qui généreraient chômage et précarité, mais une supposée insuffisante “employabilité” des individus eux-mêmes.
Ce dossier Options approfondit ce concept d’employabilité, et c’est bien une bataille idéologique décisive qui se joue pour les salariés. Car accepter sans résistance cette logique d’individualisation, ce serait renoncer aux conquêtes sociales qui ont structuré notre modèle. Ce serait ouvrir la voie à une société où chacun deviendrait un entrepreneur précaire de sa propre survie économique, dans un marché du travail organisé de façon permanente pour exploiter les « ressources humaines ».

L’employabilité, un faux ami du salariat
Anatomie d’une manipulation idéologique
Dès les années 1920, le concept apparaît dans les politiques d’insertion sociale au Royaume-Uni. Mais c’est à partir des années 1990 qu’il acquiert sa dimension idéologique actuelle et la bascule s’opère en 1998, lorsque l’employabilité devient un axe prioritaire de la stratégie européenne pour l’emploi. Ce tournant institutionnel marque l’abandon des politiques macroéconomiques de plein-emploi, au profit d’une approche microéconomique centrée sur l’adaptation individuelle. Le chômage n’est plus analysé comme un problème structurel (lié entre autres à la financiarisation de l’économie) mais comme un défaut de qualifications ou d’adaptabilité des individus.
Reporter sur les individus la responsabilité de leur employabilité future
Cette transformation conceptuelle correspond parfaite ment aux besoins du capitalisme contemporain : externaliser les coûts de formation et d’adaptation vers les salariés eux-mêmes, tout en préservant une « flexibilité maximale » pour les entreprises. Les salariés, eux, doivent gérer leur adaptabilité…
La force de cette manipulation réside dans la plasticité même du concept, suffisamment floue pour rallier à lui une variété d’acteurs aux intérêts divergents : les entreprises externalisent ainsi les coûts de formation, les pouvoirs publics reportent la responsabilité du chômage sur les individus, les chômeurs eux-mêmes intériorisent progressivement l’idée qu’ils seraient responsables de leur situation…
Une polyvalence sémantique qui constitue la force idéologique du concept
Un consensus de façade s’est ainsi construit, imperméable à toute critique sociale. Car qui oserait s’opposer à l’idée que chacun doive développer ses qualifications? Qui contesterait la nécessité de s’adapter aux évolutions technologiques? Mais derrière cette rhétorique de la responsabilisation se cache une logique profondément antisociale.
L’employabilité transforme les rapports de force collectifs en stratégies d’adaptations individuelles
En individualisant la question de l’emploi, l’employabilité transforme les rapports de force collectifs en stratégies d’adaptations individuelles. Elle fait de la solidarité un archaïsme, remplacé par la concurrence généralisée entre salariés, face à des emplois qui se raréfient.
Une mise en danger de la reconnaissance des qualifications
Dans ses repères revendicatifs, la CGT a toujours mis l’accent sur la reconnaissance des qualifications, en premier lieu le niveau d’études, sans oublier celles acquises ensuite par l’expérience ou la formation professionnelle.
Récemment, les DRH ont tenté de substituer le terme assez flou de « compétences », à celui de « qualifications », avant d’y préférer celui « d’employabilité ». Et lors des négociations collectives, les directions s’étonnent que la CGT fasse le distinguo, feignant de considérer « compétences/qualifications/employabilité » comme « la même chose… à peu près » ! Pourtant, un ingénieur possédant une expertise en intelligence artificielle, embauché sur un emploi de développement classique, va naturellement apporter à son travail une valeur ajoutée supérieure à celle strictement requise. Cette surproductivité, générée par ses qualifications, sera intégralement captée par l’employeur, sans contrepartie salariale proportionnelle, puisque la rémunération reste fixée sur l’intitulé de l’emploi et non sur les compétences réelles mobilisées.
Un “surtravail gratuit” et une plus-value générée par la surqualification intégralement captée par l’employeur
Ce mécanisme constitue un “surtravail gratuit”. L’employeur bénéficie d’un travail de niveau ingénieur expert, tout en ne rémunérant qu’un emploi d’ingénieur généraliste. Cette appropriation de la plus-value générée par la surqualification représente une forme moderne d’exploitation, d’autant plus pernicieuse qu’elle se pare des atours de la modernité managériale.
Une montée en qualification qui n’est pas reconnue
Cette déconnexion entre salaire et compétences réelles liées aux qualifications constitue l’un des piliers du système. Alors que la logique voudrait que la rémunération soit fonction de la valeur ajoutée apportée, c’est l’intitulé de l’emploi qui détermine le salaire, ce qui décourage l’engagement et l’innovation puisque la montée en qualification n’est pas reconnue. L’employeur exploite ainsi des ressources humaines qualifiées à moindre coût.
Une grille « salariale » doit toujours être couplée à une grille des qualifications
C’est pour cela qu’une grille « salariale » doit être couplée à une autre, cachée et implicite, celle des qualifications. C’est ce qu’a proposé la CGT du BRGM au personnel pour rétablir une grille salariale, en vue de futures négociations, afin de mettre fin aux actuelles cartes de rémunération par emploi. C’est totalement à l’opposé de la nouvelle convention collective de la métallurgie, qui, sous la pression du patronat, vient d’abandonner toute référence aux qualifications acquises : l’exemple à ne pas suivre !
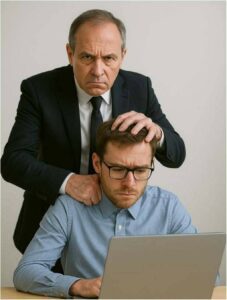
Les ICTAM dans l’étau de l’employabilité
Les ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise occupent une position particulièrement révélatrice des contradictions de l’employabilité. Pris dans l’étau de l’injonction : « Je dois rester performant tout en anticipant les mutations futures », ils subissent une pression permanente qui érode progressivement leurs conditions de travail, leur santé et leur capacité d’action collective.
L’inadéquation organisée entre salaires, emplois et qualifications conduit à ce qu’ils se retrouvent en situation de surqualification par rapport aux exigences de leur emploi, alors que les employeurs parlent de “pénurie de talents” ! Au-delà de la frustration financière, les conséquences psychologiques sont considérables dont la perte de sens du travail qui alimente directement les phénomènes de burn-out et de désengagement professionnel.
L’injonction permanente à la mobilité, présentée comme une opportunité d’évolution, masque en réalité une stratégie patronale de fluidification du marché du travail. Les salariés doivent être “agiles”, “naviguer entre les projets”, “se réinventer”. Mais cette mobilité repose sur l’initiative individuelle, sans accompagnement réel de l’entreprise. Elle génère anxiété et précarité, surtout lorsque la famille est enjeu et que les compétences relèvent d’une expertise spécialisée.
Quand l’employabilité détruit le travail
Cela génère un paradoxe saisissant : alors qu’elle est censée sécuriser les parcours professionnels, elle produit une dégradation généralisée du rapport au travail, dont l’intensification est une des conséquences les plus visibles. Car sous couvert d’améliorer leur employabilité, les ICTAM se voient confier des périmètres de responsabilités toujours plus larges, des objectifs plus ambitieux, des délais plus contraints. Cette extensification des tâches s’accompagne d’une logique de polyvalence forcée qui peut conduire à un éparpillement des missions et à une perte de maîtrise professionnelle.
Polyvalence forcée, éparpillement, perte de maîtrise professionnelle
Le mécanisme psychologique est particulièrement pervers : la culpabilisation anticipée. Le salarié, intériorisant l’idée qu’il doit constamment prouver sa valeur pour rester “employable”, s’auto-exploite en multipliant les heures supplémentaires non rémunérées, en acceptant des charges de travail déraisonnables, en renonçant même parfois à ses droits au repos.
Pour rester “employable” le salarié s’auto-exploite
Les risques psychosociaux organisationnels constituent une autre dimension cruciale de cette dégradation. Selon les études de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques, (DARES), 47 % des cadres se déclarent en situation de stress chronique lié à la surcharge de travail et à la peur de ne pas répondre aux attentes. Le burn-out, le bore-out, mais aussi la perte de sens sont des pathologies professionnelles directement liées à cette logique d’employabilité permanente.
La précarisation s’aggrave face à l’injonction d’employabilité
En 2023, plus de 85 % des embauches dans le secteur privé étaient en CDD ou en intérim, avec une majorité de contrats de moins d’un mois. Cette explosion des contrats précaires révèle l’instrumentalisation de l’employabilité pour justifier l’instabilité généralisée des emplois.
La réforme de “France Travail” cristallise cette logi que coercitive en institutionnalisant la pression sur les demandeurs d’emploi. Cela illustre comment l’employabilité, présentée comme un outil d’émancipation, devient en réalité un mécanisme de disciplinarisation des classes populaires.
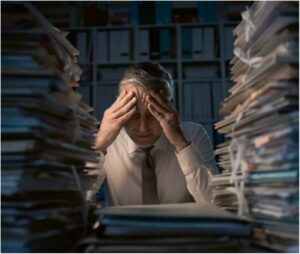
Face à cette offensive, l’Ugict propose une alternative structurante
Un droit à la qualification, conçu non comme une obligation d’adaptation, mais comme un droit fondamental attaché à la personne : au moins 10 % du temps de travail annuel consacré à une formation choisie, sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Cette proposition rompt avec la logique actuelle où la formation repose sur l’initiative et souvent aussi sur un financement personnel.
La reconnaissance salariale des compétences réelles est indispensable. Il faut découpler salaire et emploi pour établir un lien direct entre rémunération et qualification effective, pour mettre fin à la captation patronale de la surproductivité générée par les compétences réelles supérieures non reconnues. Elle suppose de mettre en place des grilles de classification transparentes et progressives, valorisant les qualifications acquises, y compris par l’expérience.
Enfin, le projet de Nouveau Statut du Travail Salarié (NSTS) porte un socle de droits transférables, garantis et opposables comme un CDI à temps plein à l’embauche, des droits à la qualification et à la protection sociale attachés à la personne et non au contrat, la portabilité intégrale des droits en cas de changement d’employeur, et déroulement de carrière sécurisé avec reconnaissance de l’ancienneté et des acquis de l’expérience… Le NSTS mettrait fin à la logique court-termiste de gestion du “capital humain”, pour instaurer un modèle protecteur et émancipateur qui transformerait fondamentalement le rapport de force entre salariés et employeurs. Il garantirait une sécurité économique qui constitue la base de toute liberté véritable.
Reconquérir le pouvoir d’agir ensemble
L’employabilité est un véritable outil de régression sociale qui individualise la responsabilité de l’emploi, désarme les résistances collectives et légitime l’aggravation de la précarité. En transformant la formation en obligation morale plutôt qu’en droit social, elle reporte sur les salariés des responsabilités et des coûts qui devraient être pris en charge collectivement par les entreprises.
Pour que cette alternative voit le jour, il faut intervenir dans les entreprises, se mobiliser, porter le débat dans l’espace public… Cela suppose de dépasser l’isolement dans lequel la logique d’employabilité enferme chacun, pour retrouver la force du collectif. Cette mobilisation passe par une bataille culturelle pour déconstruire les apparentes évidences du discours managérial : expliquer, démontrer, convaincre que l’employabilité n’est pas une fatalité moderne mais un choix, politique et social, toxique.
L’employabilité n’est pas une fatalité moderne mais un choix, politique et social, toxique
Les tensions sociales actuelles et la remise en cause des conquis sociaux nous offrent paradoxalement une opportunité pour gagner. La crise de sens que vivent les ICTAM, les difficultés croissantes à concilier vie professionnelle et vie personnelle, la dégradation des conditions de travail… créent les conditions d’une prise de conscience collective.
Le travail n’est pas une marchandise mais un facteur d’épanouissement personnel et de progrès social
Ou nous acceptons de vivre dans une société où chacun devient l’entrepreneur précaire de sa propre survie économique, ou nous construisons un modèle social où le travail redevient un vecteur de dignité, de reconnaissance et d’émancipation.

Glossaire
Employabilité : Concept managérial qui reporte sur l’individu la responsabilité de trouver et conserver un emploi. Présenté comme une adaptation nécessaire aux évolutions du marché du travail il constitue en réalité un outil d’individualisation et de précarisation.
Qualification : Ensemble des diplômes, certifications et acquis formels qu’une personne porte, indépendamment de l’emploi quelle occupe. La qualification détermine le niveau de reconnaissance professionnelle et salariale.
Compétences réelles : Savoir-faire effectivement mis en œuvre dans le travail quotidien, découlant des qualifications acquises par le salarié et mobilisées dans l’exercice de ses fonctions.
Emploi : Fonction ou mission confiée à un salarié au sein d’une organisation.
Surqualification : Situation où les qualifications d’un salarié dépassent les exigences officielles de son emploi, générant une plus-value captée par l’employeur, sans contrepartie salariale.
Surtravail gratuit : Concept développé par l’Ugict- CGT pour désigner la captation par l’employeur de la valeur ajoutée générée par des qualifications supérieures aux exigences de l’emploi.
NSTS (Nouveau Statut du Travail Salarié) : Projet porté par la CGT visant à créer un socle de droits transférables et garantis, permettant de sécuriser les parcours professionnels, sans recours à la logique d’employabilité.
Ugict-CGT : Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT qui défend les intérêts spécifiques de ces catégories professionnelles.
Précarisation : Processus de dégradation des conditions d’emploi et de travail, caractérisé par l’instabilité contractuelle, la baisse des protections sociales et l’individualisation des risques professionnels.

